#23: Donald Trump serait-il un bon président? Pourquoi tant de pessimisme?
Certains le disent. Et nous?
Cher Philippe,
Je me souviens des commentaires qui avaient accompagné la première élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le républicain serait un président disruptif qui allait faire bouger les rigidités de la politique américaine et mondiale. Toi et moi n’avions pas du tout cette vision des choses, arguant déjà que la disruption n’équivalait pas à une vision politique. Menée par Donald Trump, elle créerait davantage de problèmes à l’Amérique et au monde que de solutions. Mais nous étions un peu seuls… Et nous le sommes à nouveau. Aujourd’hui, après trois mois et demi de présidence Trump 2, nous n’avons globalement pas changé d’analyse depuis le début de notre aventure journalistique sur Substack.
Donald Trump est en train de saboter aux Etats-Unis les institutions démocratiques, l’économie, les universités, les musées, le vivre-ensemble et le statut du pays dans le monde. Les touristes des pays européens, mais aussi d’Amérique latine boycottent en grande partie les Etats-Unis. Malgré ce constat, deux nouvelles font dire à certains commentateurs américains et non-américains que les journalistes critiques de l’administration Trump font dans le catastrophisme et qu’ils exagèrent la réalité de la situation américaine. La première relève du marché du travail. En avril, les Etats-Unis ont créé 177 000 nouveaux emplois. C’est beaucoup plus que prévu. La seconde nouvelle relève de l’accord conclu entre Washington et Londres pour mettre fin à la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Cet accord, qui semble très léger, n’est en rien une victoire de Trump comme il le crie déjà sur tous les toits. Mais il a permis à Wall Street de connaître une journée relativement faste, prouvant, s’il le fallait encore, que les marchés financiers continuent d’être obsédés par le court terme.
Cher Philippe, ce type de réflexion nous interpelle. Forcément. La chroniqueuse du Financial Times Rana Foroohar s’en fait également l’écho en intitulant son dernier papier “Sommes-nous trop pessimistes au sujet de l’Amérique?”. Elle cite notamment deux économistes dont l’un juge nécessaire de séparer l’administration Trump du peuple américain et du pays. C’est une illusion de croire qu’on peut séparer ce qui est décidé à la Maison-Blanche de la réalité politique, économique, juridique, journalistique et académique des Etats-Unis. Pour qu’une économie prospère, il faut de bonnes conditions-cadres, une stabilité politique, juridique et économique.
L’amateurisme avec lequel l’administration Trump a déclaré sa guerre commerciale au monde entier ne va pas disparaître de sitôt. Oui, l’économie américaine nous a souvent surpris par sa capacité de rebond, par sa résilience. Mais Donald Trump sape ses fondamentaux: solidité du dollar, de la Réserve fédérale, des bons du Trésor. Le climat de haine qu’il propage promet des troubles évidents au sein de la société américaine qui est très inquiète de la direction que prend le pays. Les poids et contre-poids qui garantissent la démocratie américaine flanchent. L’autocratisation du pouvoir américain sous Donald Trump n’incite pas à l’optimisme. Il devrait plutôt inciter à la résistance tous azimuts.
L’optimisme, cher Philippe, est un mythe fondateur des Etats-Unis. On l’a constaté à de nombreuses reprises, après des crises ou des catastrophes, des Américains qui avaient tout perdu réussissaient souvent à se relever. Mais aujourd’hui, il faut prendre la mesure de ce qui se passe outre-Atlantique. Le système judiciaire américain est soumis à un stress sans précédent, contesté en permanence par Donald Trump. Les médias traditionnels ne sont plus les bienvenus à la Maison-Blanche, laquelle privilégie de “nouveaux médias” qui sont en réalité des influenceurs du mouvement MAGA.
Le chaos que Donald Trump a créé sur la scène internationale laissera des traces. Son incohérence totale par rapport à l’Ukraine montre à quel point il ne maîtrise rien du dossier. Sa bromance avec Vladimir Poutine qu’il admire semble tourner court. Du moins pour le moment. Il porte une forte responsabilité, hormis le gouvernement Netanyahou bien sûr, pour l’innommable faillite de l’humanité à Gaza. Le faiseur de “deal” est plutôt le faiseur de fiascos à répétition. Aucun accord, même celui avec le Royaume-Uni, ne justifie la guerre commerciale de Trump. Avec les Chinois, aucune discussion n’a eu lieu jusqu’ici contrairement aux affirmations du président américain. Des pourparlers auront lieu pour la première fois à Genève entre Pékin et Washington, mais sans la garantie qu’ils débouchent sur de vraies négociations. Même si les droits de douane causent de graves dégâts à l’économie chinoise, la Chine ne va pas céder face à Trump.
A l’issue de la première élection de Donald Trump en novembre 2016, on entendait souvent le voeu pieux de certains observateurs qui assuraient que le futur président allait devenir présidentiel une fois à la Maison-Blanche. Dans notre livre, cher Philippe, nous avions mis en garde contre cette nouvelle illusion. Trump est ce qu’il est et restera ce qu’il est. Aujourd’hui, on peut même se demander si sa santé mentale est intacte tant il multiplie les discours incohérents, sans la moindre pertinence en pleine conférence de presse au Bureau ovale.
Les optimistes au sujet de Donald Trump me renvoient à tous ceux qui ont admiré les premières semaines du président argentin Javier Milei en se focalisant uniquement sur quelques indicateurs économiques dont l’inflation. Comme si l’économie était un être isolé du reste de la société, du pays. Le “miracle économique” argentin a peut-être contenu l’inflation, mais précarisé nombre de fonctionnaires et enseignants. L’économie informelle, qui n’offre aucune protection sociale, est en train d’exploser.
Pour conclure, cher Philippe, une petite pensée pour un grand politologue et ex-directeur de la Kennedy School of Governement d’Harvard, Joseph Nye qui avait théorisé la notion de soft power et montré à quel point les Etats-Unis en bénéficiaient considérablement à travers le monde. Il est décédé mardi. Hors aucun président n’a sabordé autant le soft power américain que Donald Trump. Il suffit de voir la perception des Etats-Unis en Afrique où les milliards d’aide humanitaire états-unienne ont disparu ou la chute du tourisme européen aux Etats-Unis pour s’en rendre compte. Quand je l’avais rencontré en 2017 au Graduate Institute de Genève où il avait brièvement enseigné, il me le disait sans équivoque: “Je crains davantage Trump que la Chine.” Pas d’optimisme déplacé chez Joseph Nye, juste un réalisme de bon aloi.
Maintenant que nous avons un pape américain qui n’est pas en phase avec la Maison-Blanche, je me demande, cher Philippe, si la figure tutélaire des 1,4 milliard de catholiques du monde reste optimiste par rapport à son pays. Mathématicien, Léon XIV pourrait avoir de la peine avec la guerre que la Maison-Blanche mène contre la science.
Quid censes, care amice Philippe? Tu peux me répondre en français…;-)
Avec toutes mes amitiés,
-Stéphane
Mon cher Stéphane,
Comme à ton habitude, tu mets le doigt là où ça fait mal. Je choisis de répondre à tes lignes en rebondissant sur l’optimisme, une disposition plutôt naturelle chez moi mais qui semble progressivement m’abandonner depuis que j’analyse le deuxième mandat de Donald Trump avec toi sur ce Substack. Je m’agace et parfois m’insurge quand j’entends ceux qui chantent les louanges de sa “différence” et de sa capacité à mettre les choses en mouvement. Cette capacité est indéniable, mais c’est les choses et le mouvement qui m’intéressent, ce qu’il tente d’accomplir. Et la manière dont il tente de le faire, qui me semble souvent abaisser et avilir la fonction qu’il occupe. Faut-il vraiment se réjouir, pire se satisfaire, du fait que les choses n’aillent pas plus mal, que le grand disrupteur est finalement bienvenu dans son hyperactivité? Je m’y refuse, ou disons, je le pondère très sérieusement.
Barack Obama avait conquis la Maison-Blanche en jouant sur l’espoir celui de la poursuite de ce qu’il appelait “l’expérience démocratique américaine”, dont sa victoire comme premier président noir des Etats-Unis représentait un moment historique. (Je suis ouvert à une discussion sur un bilan contrasté.) La nostalgie kitsch du Make America Great Again de Trump en est l’antithèse complète. Imaginer qu’un projet politique aussi régressif que celui d’America First puisse porter en lui le moindre “optimisme” ou espoir au-delà du cercle de ceux qui l’imposent au monde et de ceux qui n’ont pas encore été décillés m’est très difficile.
Malgré la fébrilité diplomatique de ces derniers jours en prenant en compte “l’effet Trump” sur d’éventuelles percées sur des dossiers majeurs, je continue de penser que le trumpisme est par essence “hopeless”, car l’ensemble de ses prémisses sont viciées à la base par sa nature obscurantiste.
Cela étant, ma position n’est pas celle d’un rejet obtus et définitif. Je convoque simplement le plus extrême des scepticismes dans une tentative de mettre en perspective et en cohérence la totalité des actions de Donald Trump, sur plan intérieur et à l’international. Si tu devais soudainement entretenir le moindre doute à cette lecture sur ma fidélité à notre feuilleton, je te rassure, garde ton ouvre-lettres. Même si je dois t’avouer que cette attention continue à la chose trumpienne se double désormais assez régulièrement d’une immense latitude. Cette dureté nouvelle à propos de Donald Trump, dans le ton en tout cas et dans son expression publique, provoque d’ailleurs chez moi un effet assez jubilatoire, un peu comme si finalement je retirais mon doigt mouillé du vent pour me laisser aller au bonheur d’une conviction affirmée que j’entends maintenant défendre. Ce plaisir est d’autant plus manifeste que, vu la nature du boulot de commentateur, je n’aurais aucune difficulté à reconnaître que mon analyse était tout ou en partie éronnée si Donald Trump devait aller de succès en succès en contribuant à la résolution des défis du moment. (Comment définir ses succès sera une autre histoire. Résoudre les problèmes qu’il aura lui-même créés ne sera pas compté.) Mais voilà, mon bon Stéphane, que je m’emporte. Nous n’en sommes pas là, et de loin.
Digression liminaire terminée, je reviens à l’optimisme sous Trump 2. On peut comprendre, au vu de son bilan, que certains soient enclins à faire de simples mouvements des victoires majeures ou de pratiquer par segmentation sélective. Or, le trumpisme est un et indivisible. Se targuer d’un « deal » conclu, d’un effort diplomatique couronné de succès est louable et légitime, mais voilà qui ne change en rien les fondamentaux de la contre-révolution vengeresse mise en place le 20 janvier et appliquée aujourd’hui avec une nouvelle radicalité qui a surpris même les plus avertis. Dans son très beau livre, L’espérance, ou la traversée de l’impossible consacré à l’urgence climatique, la philosophe Corinne Pelluchon rejette d’ailleurs l’optimisme dont elle affirme qu’il résulte souvent d’un manque d’honnêteté et de courage ; il s’apparente à une forme de déni masquant la gravité de la situation”. Nul besoin, je pense, de m’appesantir ici sur la gravité de la situation. Elle nous poursuit, nous hante, nous saute à la figure dès notre réveil. Comment bien sûr dans ces conditions condamner le déni dans sa forme du “je-ne-veux-pas (sa)voir” d’aujourd’hui, réflexe primal et temporairement apaisant face aux horreurs accumulées que nous impose le quotidien.
Pour revenir plus directement au président qui dérègle nos journées et à tes mots sur cette accusation de négativisme « qui nous interpelle », ce n’est pas un hasard si le discours critique sur un pessimisme à l’égard de Donald Trump qui n‘aurait pas lieu d’être, émane avant tout de la finance et de l’économie. Le terminal du trader est un outil de réduction du champ de vision et de préoccupations redoutables.
La démocratie ? La séparation des pouvoirs ? La défense de l’état de droit ? L’assaut contre les minorités de genre, contre les droits reproductifs ? Le rejet du multilatéralisme, la répudiation des accords sur le climat, mais pourquoi donc s’en soucier! L’emploi ne vas pas si mal que ça, circulez, il n’y a rien a voir ou à regretter. L’œil vissé à une lorgnette étroite les thuriféraires du trumpisme n’ont d’yeux que pour les indices boursiers ou les bénéfices supposés de la réindustrialisation future de l’Amérique. Nous, mon cher Stéphane, quand nous parlons fabrique, c’est de fabrique du tissu social de la société américaine dont nous parlons car en fin d’analyse c’est sa déchirure des années durant qui a livré le pays aux populistes.
Nous sommes, dans ce sens, alignés avec une majorité des économistes américains contemporains qui considérerent que le modèle proposé par Donald Trump et les conservateurs américains est obsolète et inadapté à nos sociétés complexes, nouvel avatar d’une vision passéiste qui n’est pas sans rappeler l’obsession du président américain à propos des tarifs douaniers. Le vieux binôme déréglementation et réduction d’impôts pour relancer la croissance, expliquent-ils, a vécu depuis longtemps. Une économie saine est plus qu’une économie, elle ne peut pas fleurir durablement dans des sociétés lacérées par des tensions sociales. Dans de telles conditions, des réductions massives d’impôts telles que celles envisagées par la Maison-Blanche qui augmenteraient encore davantage les inégalités économiques que connaissent les Etats-Unis, pourraient, avertissent-ils, engendrer des fractures sociales absolument irréparables. Sans compter, autre dégât collatéral, sur une perte définitive de confiance envers la classe politique, alimentée dans le cas de Trump, par les désenchantés de la base des électeurs MAGA eux-mêmes. Comme tu en as déjà noté l’importance politique , c’est le combat contre « l’oligarchie », porté par Bernie Sanders et Alexandra Ocasio-Cortes, qui rassemble depuis le début les foules les plus larges à travers le pays. C’est un signe.
Il faut, un peu paradoxalement, aller à Davos , pour réécouter l’expression la plus cristalline de l’idée qu’il ne peut pas y avoir d’économie performante sur la durée si elle n’est pas portée par une vision sociétale inclusive, celle la-même que Washington rejette aujourd’hui. En 2022, dans son discours au WEF, Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor affirmait alors: « La conception moderne de l’économie de l’offre cherche à créer de la croissance en augmentant l’emploi et la productivité tout en réduisant simultanément les inégalités et les dégâts infligés à l’environnement ».
Mon cher Stéphane, tu mesureras combien, de la contre-révolution contre la diversité, l’équité et l’inclusion au « drill baby drill » au cœur du trumpisme, nous sommes bien loin de cette conception. Là encore, je suis prêt à prendre les paris sur les chances de succès des trumponomics. Encore faudra-t-il attendre que la guerre commerciale qui fait rage ait trouvé apaisement ou résolution. Gageons que cela prendra un peu de temps et d’efforts. Car, pour l’heure en tout cas, « c’est le bordel » pour reprendre les mots d’Olivier Blanchard, l’ancien économiste en chef du Fonds monétaire international. Il soulignait récemment sur l’antenne de France Inter que cela ne devrait pas complètement nous surprendre, puisque disait-il, nous avons avec Donald Trump à faire à un « fou furieux ». Les journalistes ne lui ont pas demandé s’il était optimiste ou pessimiste. Mais lui a réjoui ma matinée…
A très vite.
-Philippe


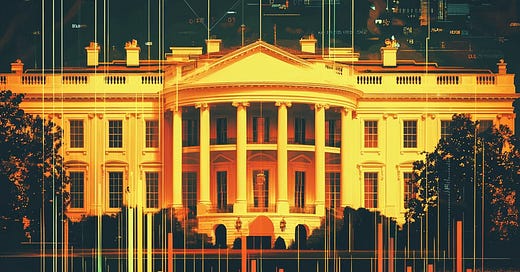




Bon président? Cela dépend de votre définition de "bon." Cet adjectif à un parent morale et un parent politique. Son fonctionnement est remarquable: Il est plus paresseux que même Reagan ne l'était, il brise toutes normes, il se fiche de la Constitution, il est entouré d'amateurs idéologues, ... Bref...
Mais il faut savoir que les médias se mettent sur les pattes arrière (même les médias alternatives qu l'on trouve sur Substack, par exemple) à chacune de ses imbécilités... Flooding the zone. Tout le monde le sait, mais tout le monde réagi bruyamment... Et lui? Il s'amuse à humilier tout le monde.
Bon: le verdict? C'est bon ça?